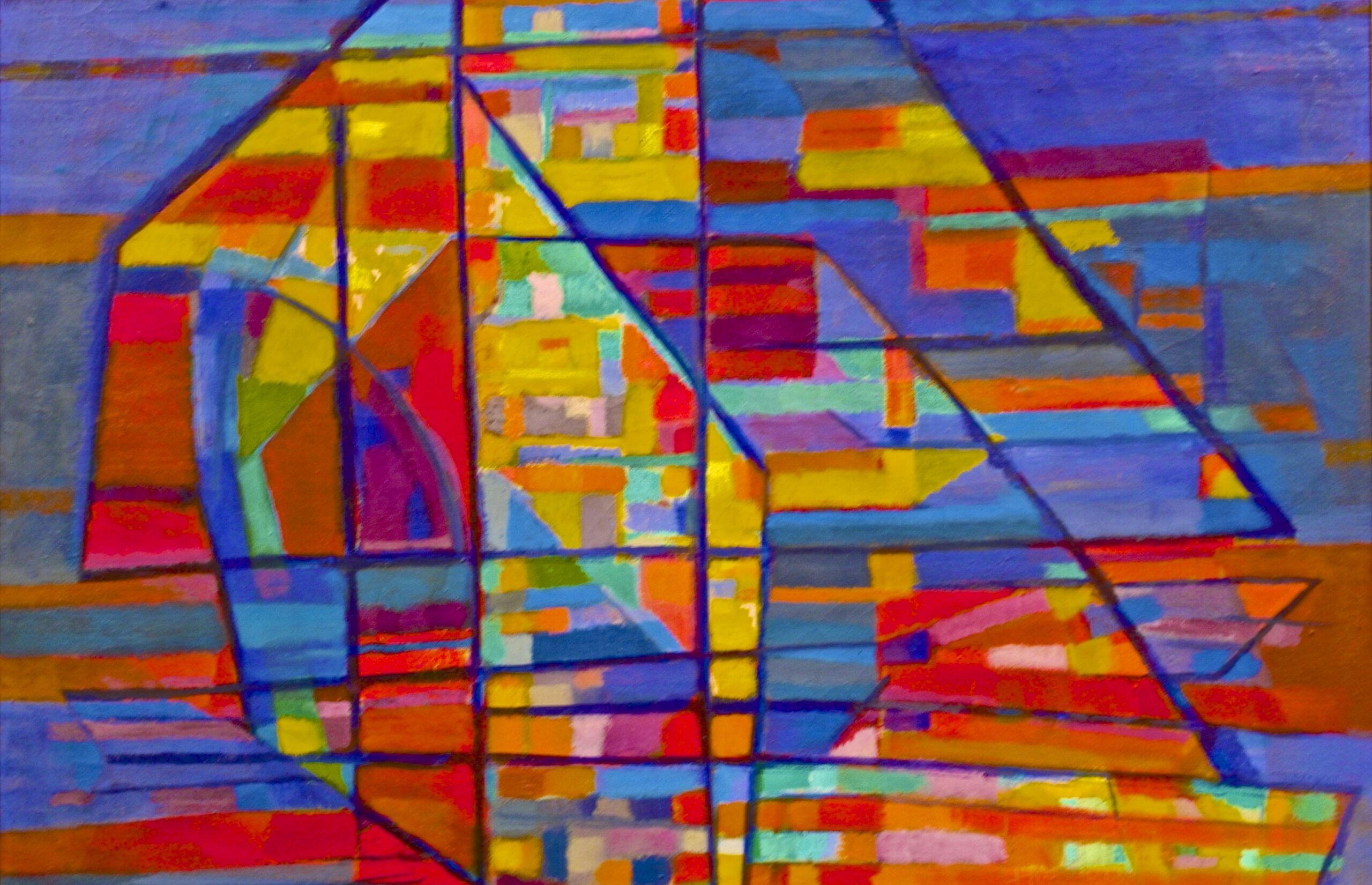Les actions étudiées incluent divers types de stratégies : la planification urbaine, les stratégies foncières, l’urbanisme opérationnel, les politiques de gestion, les projets urbains, les projets de développement territorial, la production des réseaux d’infrastructures techniques et de transport. Ceci passe aussi par un travail sur les cadres théoriques et les notions mobilisées par l’urbanisme et l’aménagement, qu’ils soient considérés comme champ de recherche ou domaine d’action.
Les recherches portent ainsi d’une part sur les caractéristiques des acteurs, les différents types de ressources (économiques, sociales, politiques, écosystémiques) dont ils disposent, les objectifs qu’ils poursuivent, les valeurs qui les animent, les groupes sociaux ciblés par leurs actions et les instruments qu’ils mobilisent. Les formes de partenariat, de collaboration et de négociation, de même que les rapports de force, les tensions voire les contradictions entre les stratégies des acteurs (publics et privés), font l’objet d’un intérêt spécifique. L’enjeu est de saisir les effets des processus, des modes de faire et des relations entre acteurs sur le contenu concret des politiques et des projets.
Elles portent d’autre part sur la matérialité de la production en urbanisme et aménagement. Il s’agit d’appréhender l’évolution des modes et des formes d’occupation des territoires, entre échelle locale et européenne, celles des réseaux et structures techniques qui en assurent le fonctionnement (eau, énergie, transport, numérique,…), comme des milieux dans lesquels ils s’inscrivent. L’enjeu est de saisir le double processus de concentration et de dispersion des différentes fonctions dans l’espace, de disjonction et/ou d’interdépendance entre territoires à travers leurs échanges, notamment dans le cadre d’une approche par leur métabolisme territorial.
Ces travaux s’inscrivent dans des problématiques marquées par le renouvellement des acteurs de l’urbanisme et de l’aménagement et de leurs relations, les mutations politiques et économiques et les changements de l’environnement, local comme planétaire. Ils portent sur des espaces très variés, des territoires métropolitains en croissance aux territoires en crise (villes en décroissance, quartiers dits « sensibles », etc.), en passant par les espaces infrastructurels (portuaires, ferroviaires). Les échelles considérées sont celles des périmètres de l’action ou du projet et peuvent correspondre à l’agglomération comme au quartier ou au simple îlot. Les travaux sont conduits dans des aires culturelles diversifiées ; en sus de l’Europe, une expertise particulière concerne les dynamiques urbaines d’Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et d’Asie du Nord-est (Japon, Chine, Hong Kong).
Quatre entrées structurent les travaux :
Réseaux, infrastructures, et territoires
Il s’agit ici d’examiner les jeux entre les acteurs (publics et privés) des réseaux à différentes échelles (locale, nationale et internationale). Dans cette perspective nous nous intéressons aux stratégies territoriales (évaluation, planification, financement, modes de gestion) relatives aux réseaux et à leurs transformations notamment d’un point de vue physique à travers les infrastructures. Une attention particulière est portée à la crise de légitimité des grandes infrastructures débattues dans des contextes variés. De plus, la prise en compte des hauts-lieux de ces réseaux, comme interfaces territoriales (gares, ports, aéroports, centres logistiques, data center) permet de questionner leur aménagement dans un contexte généralisé de décentralisation (hétérogénéité de l’action publique) et de libéralisation (pénétration croissante du secteur privé) modifiant leurs modalités de planification. Il s’agit aussi d’intégrer dans ces travaux le développement des technologies de l’information et de la communication, notamment l’effet de l’usage du numérique dans la gestion des réseaux et la fabrique de la ville.
Aménagement et métabolisme territorial
Il s’agit ici d’aborder les dynamiques urbaines à partir de leur dimension matérielle en mobilisant le champ interdisciplinaire de l’écologie territoriale et d’analyser les flux matériels et énergétiques caractéristiques de la ville et de ses relations avec d’autres territoires, comme des interactions sociétés-biosphère, flux dont la circulation est largement organisée par les réseaux. Les recherches portent sur les inflexions voire les mutations du métabolisme territorial dans une dimension à la fois spatiale et temporelle, sur la reconfiguration des réseaux qui y est associée, sur la réorganisation des acteurs et les logiques territoriales qu’elles engendrent ou qui en sont à l’origine, sur l’émergence d’autres figures de relations et d’échanges qui questionnent la pratique de l’aménagement et la gestion de l’espace.
De la planification à la production de l’espace bâti : acteurs, outils et pratiques de l’urbanisme
Les travaux se focalisent ici à la fois sur les référentiels d’action, les stratégies des acteurs (politiques et techniques), leurs modes d’action (instruments, outils et dispositifs), et le contenu matériel de la production bâtie (habitat, activités, espaces infrastructurels). Il s’agit d’analyser les différentes démarches qui permettent aux acteurs publics et privés de transformer les espaces. Une attention particulière est portée à la production de logements et à l’immobilier. L’observation des dispositifs techniques de production de l’urbain (planification réglementaire, montages opérationnels, circuits de financement) constitue une méthode privilégiée pour analyser les stratégies d’acteurs, leurs interactions et leurs conséquences sur les transformations de l’espace.
Développement territorial et actions d’aménagement
Les travaux menés visent à explorer la manière dont les démarches de développement territorial sont établies et les effets qu’elles produisent sur les acteurs et sur les territoires. Qu’ils soient impulsés d’en haut ou d’en bas, il s’agit d’analyser la manière dont sont appréhendés les territoires (catégories, concepts, outils) et sont produits les cadres (discours, concepts, politiques, actions, outils) des démarches de développement territorial à différentes échelles. L’attention est également portée sur les interactions entre les cadres produits et la manière dont ils sont incorporés et transformés au moment de la mise en œuvre de ces démarches ; voire, dont les cadres en question sont interrogés par la confrontation à la diversité des acteurs à différentes échelles et/ou aux caractéristiques mêmes des territoires concernés par les démarches de développement territorial.

Développement urbain en Chine. Centre ville de Guangzhou, Chine. Août 2018 © Cinzia Losavio.