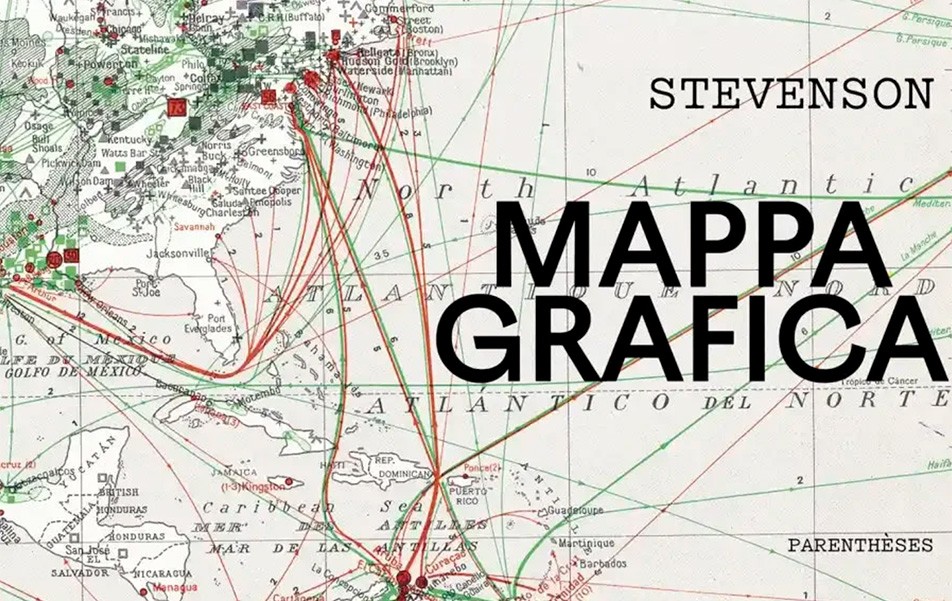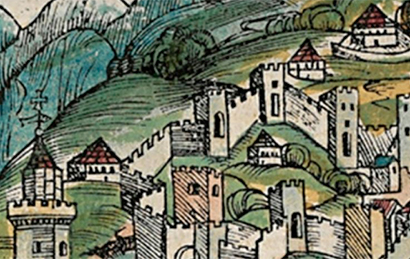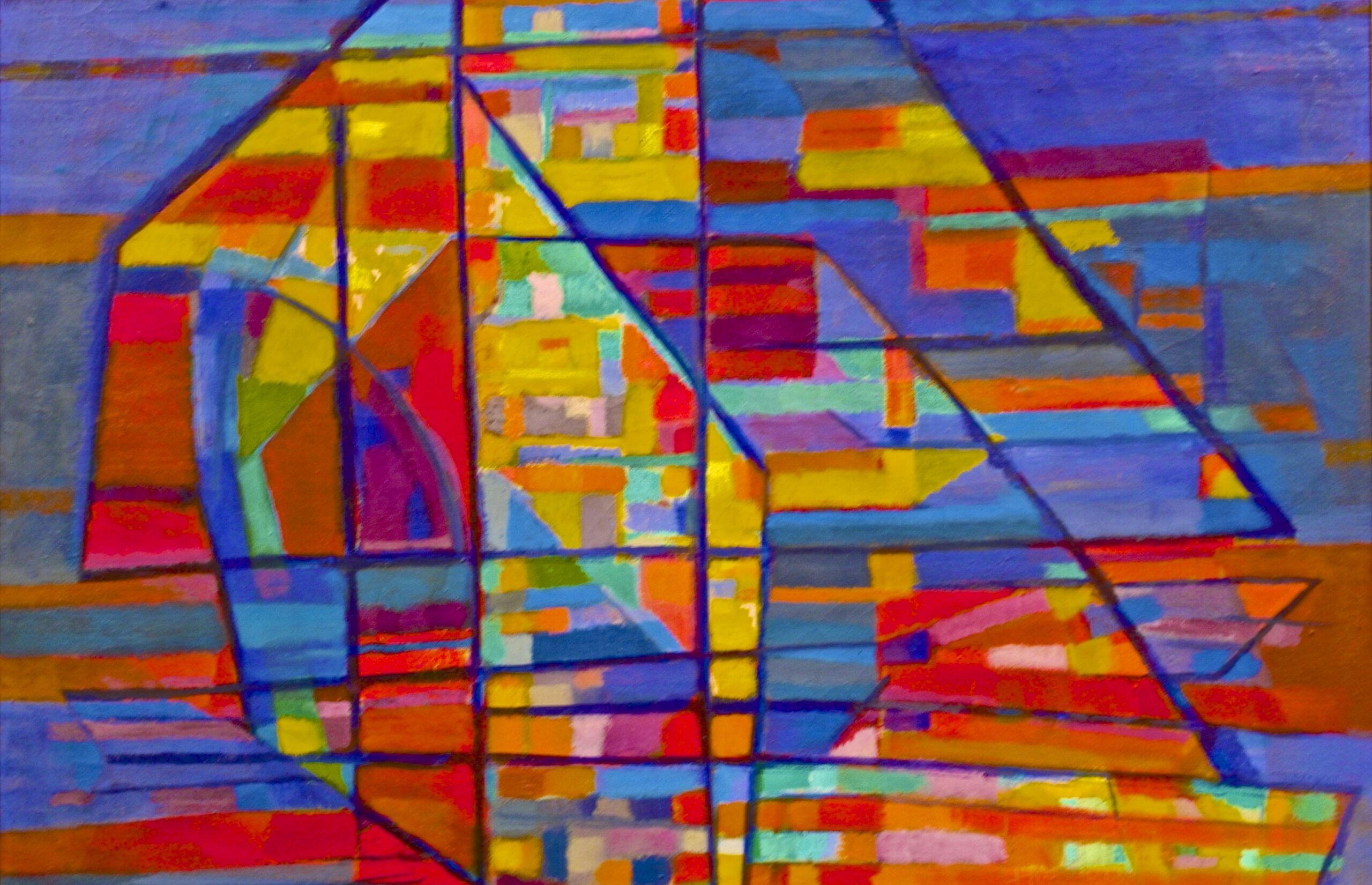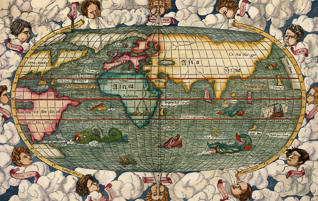L’équipe Épistémologie et histoire de la géographie (EHGO) existe sous cette appellation depuis 1987, date à laquelle elle prit le relais du Centre de géohistoire. Elle est la seule équipe CNRS dédiée à ces champs. Elle a participé à de nombreuses initiatives interdisciplinaires dès les années 1970 et n’a cessé depuis de dialoguer avec d’autres historiens et épistémologues des sciences humaines. À partir des années 2000, elle a ouvert son périmètre à de plus larges « savoirs de l’espace », incluant des travaux d’architectes et d’urbanistes, d’ingénieurs, de paysagistes, d’aménageurs, etc. Elle a également refait une place à la géohistoire et à la géographie historique.
L’équipe EHGO a développé un savoir hautement spécialisé, nourri de l’ensemble des transformations de l’historiographie et de l’épistémologie des champs qui lui sont connexes. Elle a toujours valorisé ou impulsé un travail collectif. S’attachant à mettre à jour l’élaboration des savoirs géographiques, elle n’en néglige pas pour autant l’histoire sociale des savants ou les contextes politiques ou cognitifs. Elle met l’accent sur une histoire longue des objets et sur les effets configurants des médiations (cartes, textes, schémas, catégories…) et des enjeux politiques, sociaux et institutionnels.